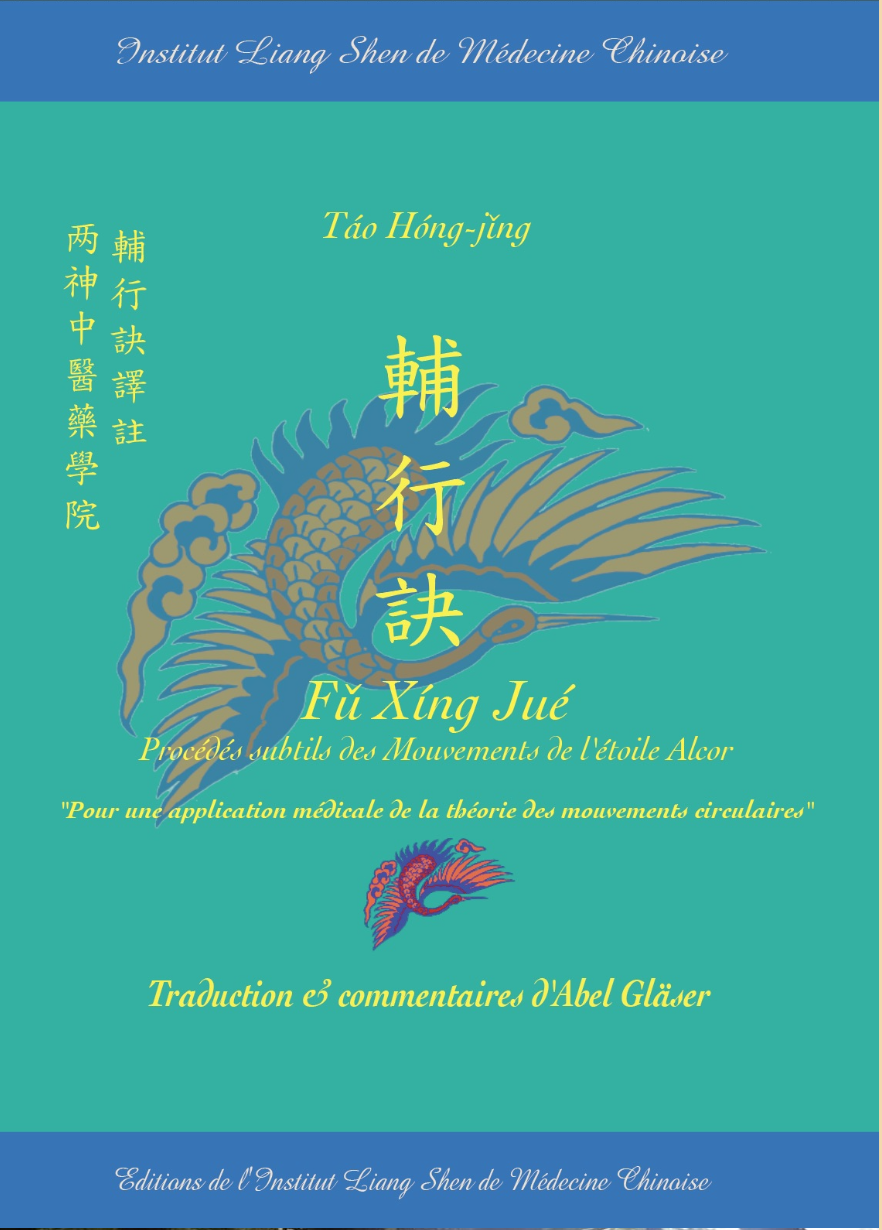Editions de l’Institut Liang Shen de Médecine Chinoise
Táo Hóng-jǐng
輔行訣
Fǔ Xíng Jué
Procédés subtils des Mouvements de l’étoile Alcor.
Traduction & commentaires : Abel Gläser
L’institut Liang Shen de Médecine Chinoise a l’immense plaisir de vous annoncer la parution en langue française du Fǔ Xíng Jué (輔行訣 Procédés subtils des Mouvements de l’étoile Alcor) de Táo Hóng-jǐng.
Découvert récemment, le Fǔ Xíng Jué (Procédés subtils des mouvements de l’étoile Alcor), écrit par Tao Hong-jing (456-536), constitue un socle fondamental dans la compréhension des huit domaines de formules et des seize formules racines qui forment le socle principal du corps du Shānghán Lùn (Traité des blessures dues au Froid).
Il apporte un éclairage ainsi que des fondements cliniques et théoriques qui n’apparaissent pas toujours aussi clairement dans l’oeuvre de Zhang Zhong-jing elle-même, ce qui en fera certainement un texte majeur pour l’accès à une pédagogie plus solide du diagnostic et du traitement dans la pratique des jing fang (stratégies classiques) pour celui qui ne veut pas s’écarter du principe primordial de la médecine du vivant : le mouvement.
Le texte se lit comme un petit trésor, on pourrait dire un véritable « Petit Classique » tant il apporte théories et applications cliniques précises, structurées et unifiées, et ceci, aussi bien pour la pratique acupuncturale selon les cinq mouvements que pour la prescription phytothérapeutique en médecine chinoise.
Táo Hóng-jǐng
輔行訣
Fǔ Xíng Jué – Procédés subtils des mouvements de l’étoile Alcor.
Traduction & commentaires : Abel Gläser
Ed. de l’Institut Liang Shen de Médecine Chinoise, juin 2018.
Format : 200 X 270mm – 216 pages – Cousu collé.
Couverture souple, laminée alu
ISBN : 978-2-8399-2637-9
Note explicative du traducteur
Le présent livre est une traduction de l’ouvrage intitulé Fǔ Xíng Jué Zāngfǔ Yòngyào Fǎyào (辅行诀脏腑用药法要 / 輔行訣臟腑用藥法要), appelé de manière simple Fǔ Xíng Jué (辅行诀 / 輔行訣). Il aurait été composé par Tao Hong-jing, un très célèbre médecin taoïste, alchimiste et écrivain qui vécut de 456 à 536 de notre ère, pendant la Dynastie Liang (梁朝).
Toute traduction est un tour de force pour parvenir à faire passer du sens au lecteur sans pour autant abandonner la formedu texte original. Ceci est d’autant plus vrai lorsqu’il s’agit de traduire du chinois classique vers le français et encore plus vraiquand il s’agit de chinois médical classique. Car il ne faut pas seulement faire passer du sens mais également permettre que ces connaissances soient pratiquement applicables sur des patients par les cliniciens et futurs cliniciens contemporains. Cela dit, si tour de force il y a, il doit se faire dans la rigueur et la finesse d’une recherche approfondie, faute de quoi il est impossible d’accomplir cette tâche sincèrement.
La version principale que nous avons utilisée pour cette traduction est la version réorganisée du Fu Xing Jue de Yi Zhi-biao (衣之镖) de 2009 car, bien que n’étant pas la plus ancienne ni la plus « originelle », c’est la version qui nous a semblé être la plus cohérente et la plus complète. Nous avons également utilisé de nombreuses autres versions pour comparaison, vérification et complément.
La copie manuscrite de Zhang Da-chang (张大昌) de 1974, qui est le médecin qui aurait eu le manuscrit originel du Fu Xing Jue entre les mains, a été évidemment fortement prise en considération.
Puis, les copies manuscrites des différents disciples de Zhang Da-chang ont aussi été utilisées pour comparaison. La copie manuscrite de Wang Zi-xu (王子旭) de 1964 semble être la plus ancienne. La copie de Fan Zhi-liang (范志良) de 1965 vient ensuite. La copie manuscrite de Liu De-xing (刘德兴) de 1975, la version photocopiée de l’Institut de Recherche en Médecine Chinoise de Chine (中国中医研究院) de 1975 dirigée par le Professeur Ma Ji-xing (马继兴) (expert en archéologie littéraire de la médecine chinoise), l’ancienne copie manuscrite de Yi Zhi-biao (衣之镖) de 1976, la version de Sun Bo-guo (孙伯果)de 1976, la version de Ding Qin-xi (丁勤喜) de 1979 et la version de Liu Zhi-zhong (刘世忠) de 1979 ont également toutes été consultées.
Par ailleurs, le Professeur Ma Ji-xing a inscrit une version du Fu Xing Jue dans l’ouvrage intitulé Dunhuang Gu YijiKaoshi (敦煌古医籍考释) (Recherche et Explication des Ouvrages Médicaux de Dunhuang) publié en 1988, pour la plupart sur la base de la version de Zhang Da-chang.
Étant donné que la version originale du Fu Xing Jue ne nous est pas parvenue, nous avons uniquement une idée du texte original par le biais des retranscriptions manuscrites faites par Zhang Da-chang et ses disciples à la fin du XXe siècle. Ces retranscriptions ayant toutes été faites de mémoire, il apparaît de nombreuses disparités entre les différentes versions, de nombreuses erreurs et de nombreux manques. Lorsque cela était possible, nous avons suivi les versions les plus anciennes citées ci-dessus mais lorsqu’il s’avérait que les erreurs menaient à une incohérence du texte,nous avons alors parfois choisi la version réorganisée de Yi Zhi-biao et de son équipe qui a permis de restructurer le texte de manière cohérente.
Au niveau de l’aspect pratique et formel de la traduction, nous avons, dans la mesure du possible, traduit tous les termes chinois en français à l’exception des termes comme yin (阴), yang (阳), qi (气), taiyang (太阳), yangming (阳明), etc. Ce sont des termes qui, à notre sens, ne nécessitent pas de traduction. Celle-ci s’avérerait hasardeuse et restrictive au niveau sémantique, ils ont donc été conservés en pinyin (transcription phonétique de la langue chinoise en écriture latine). De plus, tout étudiant ou praticien en médecine chinoise est généralement familiarisé avec ces notions-là. Ainsi, cela ne devrait pas poser de problème à la lecture. Les noms des herbes1 de la pharmacopée chinoiseont également été conservés en pinyin pour les mêmes raisons.
Les noms des substances médicinales sont toujours écrits en italique, en minuscule et en gras (ex. : « wuweizi », « ganjiang »). Une annexe en fin d’ouvrage donne les correspondances entre les noms des substances médicinales en pinyin, le nom en chinois et leurs noms latins.
Les noms des formules de pharmacopée chinoise ont été écrits en italique et en gras avec une majuscule à chaque mot (ex. : « Xiao Xie Gan Tang », « Da Yang Dan Tang »). Parfois, lorsqu’un terme est ambigu, que son sens n’est pas clair, ou alors par souci pédagogique, le terme en français est suivi, entre parenthèses, du pinyin et du chinois (ex. : « les cinq mouvements (wu xing 五行) », « le métal sec de yangming (yangming zao jin 阳明燥金) »). Le pinyin sera toujours écrit en italique dans le texte.
La langue chinoise est d’un caractère succinct, elle économise les mots. Il faut avoir à l’esprit qu’il y a 1500 ans, les techniques d’écriture demandaient beaucoup de temps. Les érudits de cette époque ne s’amusaient pas à noircir dupapier pour le plaisir, ils économisaient les caractères. Ainsi, lors de la traduction en français, il a fallu parfois rajouter des termes pour que la phrase soit compréhensible et qu’une certaine syntaxe puisse en émaner. Lorsque des termes, qui n’étaient pas sémantiquement compris dans le texte en chinois, ont été rajoutés, ils ont été mis entre crochets sans italique (ex. : « alors, la vision n’est pas claire et les yeux ne voient pas [correctement], les oreilles entendent [des bruits anormaux] », « S’il n’y a pas guérison, alors administrer à nouveau [cette formule] »).
Pour chaque passage du Fu Xing Jue, nous avons d’abord inscrit le texte en chinois, en-dessous duquel nous avons inscrit le pinyin avec les tons et, pour finir, la traduction en français du passage concerné. Le texte en français est accompagné de nombreuses annotations de bas de page contenant des explications de termes médicaux ou autres et des extraits du Su Wen, du Ling Shu, du Shanghan Lun, du Jingui Yaolüe, etc. lorsque cela pouvait compléter le texte.
De plus, nous avons ajouté quelques schémas dans le texte. Des schémas étaient déjà présents dans certaines versions chinoises du Fu Xing Jue, d’autres n’y étaient pas, mais nous les avons pensés utiles pour une meilleure compréhension de l’œuvre par le lecteur.
Nous avons fait le choix d’écrire le texte original en chinois simplifié et non pas en chinois non-simplifié. La première raison est que, de nos jours, en République Populaire de Chine, quasiment tous les textes classiques publiés sont écrits en chinois simplifié. La deuxième raison est que les caractères non-simplifiés (que l’on utilise par exemple encore à Taïwan ou à Hongkong) ne sont pas non plus tout à fait les mêmes que ceux utilisés pour écrire les textes originaux du Tangye Jingfa, du Huangdi Nei Jing, du Shanghan Lun, du Fu Xing Jue, etc. La simplification descaractères comme on les connaît actuellement en Chine continentale, et qui a commencé au début du XXe siècle, n’esten réalité pas la seule simplification d’écriture des caractères chinois au cours de l’histoire de l’Empire du Milieu. Si l’on compare les soi-disants caractères non-simplifiés contemporains avec l’écriture ossécaille (jia gu wen 甲骨文) (aussi appelée caractères oraculaires) utilisée en Chine du XVe siècle au Xe siècle av. J.-C., avec les caractères surbronze (jin wen 金文) de la Dynastie Zhou (1046 – 256 av. J.-C.), avec l’écriture en grand style sigillaire (da zhuan 大篆) utilisée avant la Dynastie Qin (221 av. J.-C. – 206 av. J.-C.), ou avec l’écriture en petit style sigillaire (xiao zhuan 小篆), qui est un style de caractères chinois unifiés entrepris sous le règne de Qin Shi Huang (秦始皇) en 221 av. J.-C., on s’apercevra qu’il y a tout de même encore beaucoup de différences. Ainsi, nous avons fait le choix de la simplicité. Le néophyte ensinologie s’en trouvera avantagé dans son étude de la langue chinoise par le biais de cet ouvrage.
Cependant, il est évidemment éminemment conseillé aux personnes s’intéressant à la langue chinoise, et notamment à la médecine chinoise, de s’investir dans l’étude des caractères chinois anciens, en commençant par l’écriture ossécaille (jia gu wen 甲骨文). Cela ne pourra que les aider à mieux appréhender la sémantique de cette langue si immensément mystérieuse.
Abel Gläser, le 20 novembre 2018 à Chengdu.
1. Le terme « herbe » correspond à la traduction du terme « yao (药) » chinois. Ce terme, autant en français qu’en chinois, est un terme général, il englobe toutes les substances médicinales, pas uniquement les végétaux mais aussi les substances animales, les insectes, les substances minérales, etc. Ce terme sera à comprendre ainsi pour l’ensemble de l’ouvrage.